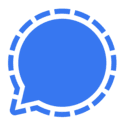Introduction
Il existe deux courants de pensée qui s’opposent fondamentalement, que nous nommerons d’un côté la pensée « moderne », de l’autre la pensée « traditionnelle ». La première est dite moderne, car c’est Descartes qui l’a récemment remis au goût du jour, mais elle est déjà très présente chez Platon. Elle est une conception du monde complètement antagoniste à la pensée traditionnelle, qui hérite quant à elle plutôt d'Aristote. L’Église catholique reprend totalement les éléments de la pensée aristotélicienne et la dépasse dans l’ordre théologique en la complétant avec les éléments de la foi catholique.
L’élément fondamental à l’origine de cette divergence entre ces deux courants de pensée réside dans la manière dont l’homme prend connaissance des choses.
La pensée moderne estime que c’est l’homme qui crée la connaissance dans son esprit. C’est l’homme qui crée dans son esprit les concepts qui lui permettent de définir ce qu’est un homme, ce qu’est une femme, ce qu’est l’argent, ce qu’est une fleur, etc. C’est donc l’homme qui dit ce que les choses sont.
De son côté, la pensée traditionnelle estime au contraire que la nature des choses est indépendante de l’homme et de son esprit. Ainsi, même si l’homme n’existait pas, les concepts de fleur, d’homme, de femme, etc., existeraient. Ce n’est alors pas l’homme qui crée dans son esprit la nature des choses, mais il reçoit cette connaissance à l’aide de ses sens (toucher, vue, ouïe, odorat, etc.). Les sens lui permettent de capter, par l’exercice de l’intelligence, l’essence même des choses dans son esprit.
Cette divergence est fondamentale puisqu’elle est à l’origine de deux paradigmes majeurs affectant la quasi-totalité de la manière dont on aborde les choses du monde. De la manière dont nous réfléchissons à la manière d’agir, de mener la politique ou de dire ce qui est moral ou non, tous les aspects de la société peuvent être bouleversés selon le postulat philosophique initial auquel nous choisissons d’adhérer.
Nous pouvons voir une première conséquence de cette divergence dans la manière dont nous définissons ce qu’est la vérité en fonction du premier ou du second point de vue. La pensée traditionnelle définit la vérité comme l’adéquation de l’intelligence – ici, intelligence de l’homme – avec ce que les choses sont, avec la réalité. Ainsi, la vérité est objective. L’herbe est de couleur verte, que je le veuille ou non, que je sois daltonien ou non… Sauf si elle est restée trop longtemps au soleil, bien sûr. Pour la pensée moderne, la vérité est quelque chose de subjectif. C’est en effet très cohérent, si la nature des choses ne sont qu’une construction de l’esprit, de même, le vert de l’herbe n’est qu’une construction dans l’esprit de la personne. Et si mon esprit construit sa propre vision de la couleur de l’herbe, et que pour moi l’herbe (en bonne santé) est bleue, alors qui êtes-vous pour dire que la construction intime de mon esprit est fausse ?
C’est dans cette vision que Descartes fonde l’humanisme, une conception philosophique qui place l’homme au centre de tout : c’est lui qui conçoit ce que les choses sont, c’est lui qui définit ce qui est vrai et ce qui est faux.
Cette conception moderne de la vérité s’applique également à la définition de ce que sont le bien et le mal. Ainsi, la moralité n’est plus à la recherche d’un bien objectif, mais est le fruit d’une réflexion purement humaine où l’homme décide indépendamment des réalités qui l’entourent ce que sont le bien et le mal.
Appliquer ces fondements philosophiques dans la société permet d’aboutir à autant de courants politiques que le libéralisme, le socialisme, le nazisme, le fascisme, le communisme, le conservatisme, comme le montre Jean Daujat dans ses nombreux ouvrages. Tantôt le bien peut être de prendre soin de la planète, tantôt de favoriser l’économie mondiale… Les politiques peuvent changer en fonction de la personne qui dirige, des idéologies dominantes, des peuples, de leurs envies et de leurs passions. Cependant, la politique n’est jamais là pour suivre une vision objective du bien et du mal : chacun a sa propre vérité, sa propre conception du bien et du mal. « Si ça fait du bien, faites-le » disait Harari dans Homo Deus en illustrant la philosophie humaniste.
Dans la philosophie traditionnelle, la conception des choses est plus simple. Il y a une vérité objective, transcendantale, qui dépasse la volonté de l’homme. L’homme travaille par son intelligence à s’y accorder et à s’y conformer. Le bien commun est donc de chercher à appliquer aussi justement que possible ce que nous savons être vraiment et objectivement bon. Nous poursuivons la quête du bien, en perfectionnant la politique pour que ce bien soit réalisé et réalisable. Nous recherchons en conséquence à nous améliorer dans le temps : petits, nous recevons une éducation qui nous apprend ce qui est objectivement bon ou mal, et plus âgés, nous le transmettons à nos enfants. C’est le principe de la tradition : recevoir et transmettre le vrai, le bien et nos valeurs. Ce qui est vrai objectivement le reste quelle que soit le temps et l’époque : la vérité transcende l’homme et les dimensions purement matérielles (espace, temps).
La question philosophique fondamentale du mode de connaissance est donc un véritable point de bascule dont les enjeux sont absolument majeurs pour la société.
Qui de la pensée moderne ou traditionnelle a raison ?
La réponse est dans la question… Si la pensée traditionnelle a raison, alors il y a bien une vérité qui nous transcende. Si c’est la pensée moderne, alors il s’agit d’une première vérité qui semble bien s’appliquer à tous de manière universelle. Les deux ne peuvent pas avoir raison en même temps, le cas échéant, nous avons un conflit irrésolvable. Pourtant, il semble que les adeptes du courant moderne s’accommodent facilement de ce raisonnement en disant qu’on peut très bien adopter une manière de pensée traditionnelle même si la pensée moderne a raison… Ce qui ne répond pas à l’objection.
Nous chercherons dans la présente réflexion à expliciter l’erreur à l’origine du courant de pensée moderne dont les conséquences sont déjà désastreuses et risquent de s'aggraver avec l’apparition des IA, qui tendent à faire disparaître la notion même de vérité.
Langage scientifique
Dans cette partie, nous chercherons à répondre à la question : qui a inventé les sciences (mathématiques, physiques, etc.) ? Répondre à cette question permettra de mettre en lumière la part que l’homme a dans la création des concepts et la définition de la nature des choses. Pour reformuler la question : l’homme n’a-t-il que découvert les formules qui régissent le monde, ou les a-t-il créées lui-même ?
À première vue, c’est l’homme, puisqu'il est évident que c’est lui qui a inventé les chiffres et les symboles qui permettent de représenter des calculs mathématiques.
Ainsi, l’homme a inventé différentes manières de caractériser le nombre d’individus dans un groupe. Cette idée de noter la quantité d’individus présents dans un groupe est très ancienne et est probablement née il y a quelques dizaines de milliers d’années pour contrôler la taille des troupeaux de bêtes, pour suivre un calendrier ou mesurer les récoltes. Les nombres semblent avoir été inventés avant l’écriture. Ce faisant, il s’agirait donc du premier système d’« écriture » très simplifié (un bâton par individu).
De ce fait, il paraît évident que l’homme est à l’origine de l’invention des nombres1. C’est bien l’homme qui a choisi arbitrairement de dire que trois individus seront notés par trois barres, ou plus tard par le chiffre « 3 » et que cela se prononcera [trois] et s’écrira « trois ». C’est aussi nous-mêmes qui avons choisi de compter dans un système décimal, avec dix chiffres (de 0 à 9). Nous avons pareillement choisi de notre propre pouvoir de dire que le nombre 0 désignerait le manque d’éléments, tandis que 1 désigne un élément seul, 2 quand on ajoute un seul élément à un élément seul, 3 quand on ajoute un élément à un groupe de deux, etc.
L’homme a donc pleinement inventé la numérotation, le dénombrement des choses. Or, puisque les nombres sont à la base des mathématiques, il serait tentant de dire que l’homme les a bien inventées, indépendamment d’un ordre transcendantal, contrairement à ce que nous explique la définition de la vérité dans la pensée traditionnelle. De la même manière que l’homme aurait inventé les maths, il serait également à l’origine de toutes les autres notions de la vie courante, de la définition de la fleur à la définition de l’homme, du bien, du mal… Pourtant, ce raccourci serait une grave erreur.
Jouons avec les maths. Si j’ai deux moutons, que je trouve deux autres moutons : j’en ai quatre. Normalement, jusque-là, tout le monde me suit. L’homme a choisi que « deux » désigne « | | » individus2. Que « quatre » désigne « | | | | » individus. Mais une chose s’impose à l’homme : si je prends un groupe de deux unités, et que j’y ajoute un groupe de deux autres unités, nécessairement, je me retrouve avec quatre unités. Le mécanisme d’addition s’impose à l’homme…
Ainsi, nous pourrions inventer un système d’écriture complètement différent. Imaginons qu’au lieu d’écrire les nombres avec dix caractères, nous utilisions un système à deux caractères : « | - ». C’est un choix tout aussi arbitraire que les dix chiffres arabes.
Ainsi, rien serait représenté par « - ». Un élément seul par : « | ». Et pour permettre de compter simplement, nous allons garder le mécanisme de « réutilisation », d’incrémentation des chiffres (qui permet de passer de 9 à 10, de « 9 » à « 1 » suivi de « 0 »). Ainsi, deux éléments sont caractérisés par « |- » et trois par « || », etc.
Imaginons que j’ajoute « |- » à « || ». Le résultat est « |-| », ce qui, dans notre système numérique correspond à 5. Ainsi, que je le veuille ou pas, quelque soit mon système de comptage, 2+3=5.
Il peut sembler absurde de créer un nouveau système de calcul. Pourtant, le système « créé » ici est le binaire, utilisé par les ordinateurs : 0 et 1 représentent deux états physiques de la matière ou de l’énergie – il y a du courant (1) ou il n’y en a pas (0). Bien que le système numérique créé ne soit pas décimal, il retourne correctement les résultats des opérations mathématiques. Le contraire serait embêtant : une application calculatrice sur ordinateur qui ne retournerait pas le même résultat qu’un boulier ou qu’un système par bâton serait embarrassant…
À travers cet exemple, nous constatons que, quel que soit le système de notation, nous n’enlevons rien à la réalité désignée.
Ainsi, l’homme a créé une grande variété de systèmes de notation mathématique, mais les opérations s’appliquent toutes de la même manière. Seulement, certaines notations sont plus faciles à comprendre et à opérer pour l’esprit humain : faire des opérations avec des chiffres arabes est plus facile pour le cerveau humain qu’avec un système binaire. Cependant, les calculs, eux, restent les mêmes. 7+5 = 12 ; 111+101 = 1100 ; 7+5 = C (en hexadécimal).
De même, nous aurions très bien pu nommer et écrire les nombres autrement, dans un autre ordre, cela ne changerait rien aux réalités désignées. Par exemple, si nous avions décrété que les premiers nombres commençaient ainsi : 2, 8, 0, 5, 6, 9, 3, 4, 7, 1. Le résultat de 8+5 serait 6… « 8 » représente ici une unité, « 5 » en représente trois, nécessairement le résultat sera quatre unités, représenté ici par le caractère « 6 ».
Si ces calculs semblent absurdes, ils montrent une chose : le fonctionnement mathématique du monde ne dépend pas de l’homme seul. Ce n’est pas l’homme qui a décrété qu’en ajoutant deux moutons à un groupe de trois moutons, il y en aurait cinq. La seule chose que l’homme a inventée, c’est le fait de nommer « deux » quand il y a deux unités.
Ainsi, même si l’homme ne nommait pas les choses – ou s’il n’existait pas – si un seul cheval rencontre un autre cheval seul dans la nature, ils seront au moins momentanément deux l’un à côté de l’autre. Cette réalité concrète mathématique nous dépasse, on ne la choisit pas, elle est.
En somme, l’homme n’a pas inventé les mathématiques. Cela semble même évident avec les formules mathématiques. Par exemple, la propriété des triangles rectangles qui permet de dire que le carré de l’hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés n’est pas une invention de l’homme, mais bien une découverte. Cette réalité est vraie quelles que soient les circonstances, peu importe le lieu, peu importe l’époque (à condition de travailler dans un plan).
Si l’homme n’a pas inventé les mathématiques, il a en revanche bien inventé le système de notation qui permet de réaliser des calculs mathématiques de manière matérielle (dans le sens large), et d’exprimer ainsi une abstraction de ce qui se déroule sous nos yeux. Mais la réalité, elle, ne change pas.
Distinction ente langage et connaissance
Il aurait été facile de dire que les mathématiques ont été inventées par l’homme seul. Pourtant, comme nous venons de le montrer, l’homme n’en a inventé que le système de notation, l’outil qui lui permet d’exprimer les réalités observées. Cet outil permet de déduire, par des raisonnements logiques, de nouvelles conclusions à partir d’observations concrètes. C’est par exemple ce qui s’est passé – dans le domaine de la physique – avec le Boson de Higgs. L’homme a postulé son existence en 1964 grâce à notre maîtrise des formules mathématiques et physiques, grâce aux outils logiques que nous avons découverts (et non inventés), mais ce n’est qu’en 2012 (soit 48 ans plus tard) que nous l’avons concrètement observé pour la première fois.
De fait, nous voyons ici de manière évidente et explicite que la réalité s’impose à l’intelligence de l’homme. Les logiques mathématiques, philosophiques, tout comme le Boson de Higgs, ont été découvertes. En revanche, ce qui change, c’est la manière de nommer et d’exprimer la réalité.
Ainsi, il ne faut pas confondre langage et connaissance.
Le langage est un outil que l’homme invente pour exprimer des réalités. La connaissance, c’est ce que l’homme retient de la réalité dans son esprit.
Ainsi, le langage peut changer, la connaissance, elle, ne change pas. Une fleur, « flower », « 一朵花 », « цветок » ou « Blomst » sont autant de manières de désigner la même réalité.
En somme, le langage est une pure création humaine et ne dépend de rien d’autre que lui-même. C’est l’homme qui a inventé arbitrairement la phonétique et l’écriture associées à chaque réalité afin de communiquer efficacement avec les autres hommes. L’homme est celui qui a nommé les réalités. Cette affirmation rejoint par ailleurs ce qui est dit dans la Bible : « Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l’homme pour voir quels noms il leur donnerait. C’étaient des êtres vivants, et l’homme donna un nom à chacun. L’homme donna donc leurs noms à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. » (Genèse, 2, 19-20)
Mais l’homme n’est pas lui-même à l’origine des réalités. La connaissance préexiste au langage. La réalité existe indépendamment du langage, ce dernier ne permettant que de l’exprimer. Le langage n’est qu’un outil pour communiquer la connaissance de certaines réalités à d’autres personnes, mais n’est pas lui-même la connaissance. La réalité, comme nous l’avons montré avec les sciences dures, ne dépend absolument pas de l’homme.
Ainsi, la connaissance n’est pas une construction pure de l’esprit. La connaissance, c’est le fait d’intégrer et de garder une réalité dans son esprit. La réalité peut être acquise aussi bien à l’aide des sens (quand on voit un objet par exemple), tantôt par le raisonnement et le langage (comme le fait cet article par exemple).
L’étymologie même du mot connaissance montre bien la dépendance de l’esprit à la réalité. En effet, le mot connaissance vient du latin « noscere » qui désigne le fait d’être « familiarisé avec », « être informé de ». En d’autres termes, la connaissance consiste à garder dans son esprit une abstraction – ou le concept – de la réalité. On ne garde évidemment pas la réalité elle-même : il serait en effet difficile, par exemple, de faire entrer une fusée Ariane 6 dans notre boîte crânienne.
Langage et connaissance en philosophie
L’« erreur moderne » est donc de faire un raccourci entre langage et connaissance. Certes, le langage est une pure invention de l’homme, mais les notions et les concepts associés au langage, plus généralement la connaissance, désignent des réalités qui, elles, ne sont pas invention de l’homme.
Ce qui est vrai en science est tout aussi vrai en philosophie.
Les mathématiques ne sont pas une construction de l’esprit. D’une part, l’homme a découvert les formules mathématiques (connaissance qui s’impose à son intelligence), et d’autre part, il a inventé la manière dont il exprime cette connaissance. De même en philosophie, les notions et les concepts ne sont pas des inventions de l’esprit humain, mais ce sont les moyens de les exprimer qui sont des inventions de l’homme. De telle sorte que l’herbe n’a pas la même couleur que le ciel, quelle que soit notre manière de nommer les couleurs.
L’homme ne peut donc pas inventer sa propre vérité. Si l’homme exprime quelque chose qui est contraire à la réalité, alors il est dans l’erreur ou le mensonge.
De même, si x+6=18, je serais dans l’erreur si je dis que x=0… même dans ma propre conception des maths, qui serait alors elle-même erronée.
De même, les concepts philosophiques ne dépendent pas de moi. La vérité est l’adéquation de l’intelligence à la réalité. Ainsi, les notions de bien et de mal ne dépendent pas uniquement de moi, de ma conception du monde (qui peut être erronée).
En revanche, certaines connaissances peuvent être vraies dans un espace réduit ou à un moment donné seulement. Par exemple – et certains l’utilisent comme argument en faveur de la pensée moderne – si je dis que j’ai froid et que mon voisin lui dit avoir chaud, cela ne veut pas forcément dire que l’un ment et l’autre non. Mais comme le souligne la structure de la phrase, « j’ai » désigne la personne individuelle et n’implique en rien ce que ressent l’autre. La vérité ici correspond à dire « j’ai froid » si effectivement mes sens me font sentir que j’ai froid. La vérité dépend d’un référentiel qui se rapporte à moi seul. Dire « il fait froid » pourrait être considéré comme un abus de langage… Car, cette phrase ne dit pas par rapport à quoi il fait froid. Elle ne pose pas le référentiel, le contexte auquel s’applique la phrase3.
En revanche, si nous posons la question : « Dieu existe-t-Il ? », la phrase pose bien un référentiel universel. La réponse, une fois trouvée, s’impose alors à tous.
Ainsi, les connaissances dépendent plus ou moins d’un référentiel donné, tout dépend de l’objet désigné et de sa portée.
Parler de la question du bien et du mal peut en revanche être sensible. Certains actes concrets peuvent être mauvais dans un cas, bon dans l’autre. Par exemple, déplacer une chaise : cela peut être mauvais si le professeur d’une classe l’a expressément interdit (il y a désobéissance), mais cela peut être très bon si c’est pour dégager le passage à une personne âgée.
De même pour la question « est-il bon de tuer un homme ? ». Tout le monde voudrait répondre « non ». Effectivement, naturellement, notre conscience nous porte (ou devrait nous porter) à vouloir défendre toute vie humaine. Ainsi, la question sortie de tout contexte nous pousse naturellement à apporter une réponse négative. Mais supposons que « un homme » désigne dans une situation particulière un terroriste qui garde en otage des femmes et des enfants qu’il tue successivement. Il peut alors sembler juste que tuer cet homme est un acte bon, non l’acte lui-même de tuer, mais parce que le contexte fait que la finalité n’est pas de tuer l’assaillant, mais de défendre les nombreux innocents.
Ainsi, le bien et le mal font partie des notions difficiles à définir et à exprimer de manière absolue, car il y a toujours un décalage entre la réalité concrète, la connaissance et le langage. Mais nous pouvons retenir que les notions de bien et de mal, en elles-mêmes, ne dépendent pas de l’homme. De même pour tout autre concept philosophique, comme la liberté, la justice, la vérité, l’amour, etc. Certaines définitions sont fausses, d’autres sont justes, d’autres sont à améliorer. L’homme se doit donc de chercher la juste définition des choses avec objectivité. Il ne doit alors pas chercher à créer sa propre conception des réalités, mais bien les définir et les nommer conformément au langage existant afin d’ouvrir l’esprit à une connaissance plus aiguisée des concepts.
Comment faire le bien et éviter le mal si nous n’avons pas d’abord connaissance de ce que sont le bien et le mal ? Tout simplement, en commençant par chercher la vérité.
Conclusion
Nous pouvons à présent affirmer que la vérité n’est pas une simple construction de l’esprit. Nous ne nommons pas les choses pour qu’elles correspondent à notre vision des choses, mais nous les nommons parce que nous découvrons qu’il existe des réalités très diverses dans le monde (un cheval n’est pas un âne). La vérité est plutôt l’adéquation de notre esprit aux choses que nous découvrons. Et le langage a été inventé pour exprimer cette vérité de la façon la plus précise possible.
Pour cette raison, il est important de s’entendre sur la définition des mots. Si chacun a sa propre définition des mots, alors pourquoi utiliser le langage ? Le but du langage, justement, est de désigner des réalités afin de les distinguer entre elles. Ainsi, plus une langue a de mots, plus cette langue sera capable de distinguer des réalités subtiles, et permettra à leurs locuteurs d’avoir une grande liberté de réflexion et d’expression. Dans le cas contraire, cela peut amener à des incompréhensions. C’est d’ailleurs tout le jeu des traducteurs. Par exemple, comment traduire en français « Estimated time of arrival » ? La réponse dépend du contexte : « Time » peut vouloir dire « temps » ou « heure ». Ici, la distinction entre l’heure et le temps n’est pas faite, là où le français fait cette distinction plus nettement.
Retenons donc qu’utiliser les mots à bon escient est important. Le travail de nos ancêtres pour créer les mots et définir les réalités qu’ils désignent n’est donc pas là pour nous asservir. Bien au contraire, ils sont là pour nous libérer, pour mettre en lumière les subtilités de la réalité, pour nous aider à communiquer entre nous et mieux comprendre le monde. La langue est par conséquent l’un des héritages les plus précieux d’une génération à l’autre.
L’erreur moderne réside donc dans la confusion entre langage et connaissance. Nous avons confondu ce que l’homme nomme avec la réalité qui est nommée.
Face à de nombreux problèmes aujourd’hui, une part de la population change sa définition de ce qui est bien ou mal… Par exemple, agir en écologiste serait bien, le reste serait mal… Voilà une affirmation où la définition du bien et du mal est purement inventée par l’homme et ne puise dans aucune vérité objective.
Souvent, ces mêmes personnes ne définissent pas les termes qu’ils utilisent. Les mots ne sont plus tant désignés pour la réalité qu’ils désignent que pour revendiquer une position, une manière d’agir. Pensons-nous que les notions de gauche et de droite existent pour désigner une réalité objective ? Ou plutôt pour s’opposer l’un à l’autre ?! Car, selon que la personne est d’un bord ou de l’autre, la définition de ces deux termes va changer.
Tristan Harris, développeur chez Google, témoignait à propos de l’ingérence des IA dans les réseaux sociaux : « si on n’est pas d’accord sur le fait même que la vérité existe, on est foutu. La vérité, c’est la clé. »
Les sociétés humaines ne peuvent fonctionner que si nous nous attachons à la vérité, à ce que les choses sont. Quand on refuse la vérité, on refuse l’ordre qui ordonne la nature au bien. Quand on refuse la vérité, on agit contre l’ordre de la nature tant au sens large (nature des choses) qu’au sens de l’environnement.
Nous devons cesser de vouloir créer nos propres réalités. Au contraire, nous devons découvrir ce qu’est objectivement la justice, la liberté, le bien, le mal, et toutes ces autres notions si importantes à la vie en société. C’est la seule manière d’assurer un équilibre qui tend à la paix et au bonheur de tous.
Rappelons simplement la distinction entre chiffres et nombres. Les chiffres sont à l’alphabet, ce que les nombres sont aux mots. Les chiffres sont des caractères qui permettent d’écrire des nombres qui, eux, désignent une quantité.↩︎
Un individu = « | »↩︎
Ce qui n’empêche pas de comprendre très bien la phrase au vu des circonstances.↩︎